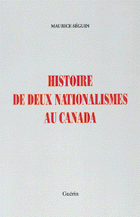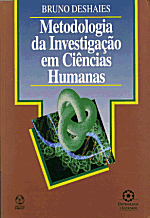« Vivre, c'est agir. »- François Robichaud
 Rond-Point Accueil > Histoire > Maurice Séguin > « Vivre, c'est agir. »
Rond-Point Accueil > Histoire > Maurice Séguin > « Vivre, c'est agir. »
« Vivre, c'est agir. »
par François ROBICHAUD*
Le Rond-Point des sciences humaines est heureux d'éditer dans l'Internet un second essai inédit de François Robichaud portant sur la notion «vivre, c'est agir» dans la pensée de Maurice Séguin.
Cette nouvelle analyse de la pensée de Maurice Séguin vise à mettre en évidence l'importance d'exister (c'est-à-dire de « vivre » pour « agir ») tant au plan individuel que collectif sans être remplacé. Elle nous empêche de nous consoler d'illusions ou de tronquer la réalité historique qui nous conditionne depuis des générations. La notion d'annexion est au coeur même de cet essai, car c'est à partir de là que peuvent se comprendre les notions de remplacement, d'inaction et d'oppression essentielle et accidentelle.
Pour mieux comprendre l'aspect historique des « normes » de Maurice Séguin, il faut joindre la lecture de « l'explication historique » contenue dans sa synthèse de l'évolution politique (et économique) des deux Canadas. Il s'agit du livre :
- Histoire de deux nationalismes au Canada (Montréal, Guérin, 1997)
Selon François Robichaud: «Tout groupe qui se reconnaît distinct veut acquérir ou conserver, étendre ou défendre son autonomie dans tous les domaines à la fois : politique, économique et culturel. » Ainsi, un groupe qui se reconnaît distinct cherche à défendre son autonomie interne et son autonomie externe. Or, dans le cas d'une société annexée, le nationalisme « se dérègle», comme il le note courageusement.
Les péquistes, les bloquistes, les autonomistes et les souverainistes en général auraient intérêt à réfléchir et à méditer sur ce texte qui replace le « problème » du Québec sur des notions fondamentales en rapport avec son objectif d'indépendance.
Bruno Deshaies
Québec, 14 octobre 2004
Maurice Séguin était un observateur avisé de son temps. Il l'était d'autant plus qu'il avait cette capacité d'analyser le présent dans son rapport au TEMPS.
Si l'on tient pour avéré que vivre, c'est agir ; qu'agir par soi-même est la force motrice de tout progrès, on reconnaît implicitement que tout ce qui contrarie cette force entraîne chez le sujet une diminution de sa valeur d'être, une déchéance.
Si la libre disposition de soi-même est source d'expérience, d'aptitudes et d'initiative, priver quelqu'un de son autonomie le condamne à la stagnation, la régression et la timidité. L'atteignant foncièrement, un tel préjudice constitue une oppression essentielle.
Le remplacement réduit à l'inaction
Qui me remplace me réduit à l'inaction. Il m'opprime dans la mesure même où, me privant de l'usage que je peux faire de ma liberté, il joue les substituts et ce, bon gré mal gré. Être remplacé est un mal en soi qui, même involontaire, n'en produit pas moins tous ses effets incapacitants.
Agir par soi permet d'agir avec d'autres. Remplacé, cela m'est impossible. L'unique autre auquel je sois confronté est mon substitut, dont je dépends. Pour avantageux que me soit ce rapport, son principal bénéficiaire est mon remplaçant celui qui agit à ma place : lui seul, en faisant, se fait. Ce que j'obtiens en contrepartie ne compense pas ce que j'ai perdu : mon autonomie. L'occasion de me réaliser m'est interdite tant que je n'agirai pas pour moi-même, par moi-même AVEC d'autres. S'imposer comme substitut, c'est agir à l'encontre de celui qu'on remplace, même lorsqu'il s'en accommode ou qu'on s'y voit contraint.
Analogie entre l'individu et la société
Agir par soi est le substrat de la vie individuelle comme de la vie collective. Une collectivité ne peut vivre c'est-à-dire agir seule mais avec d'autres que lorsque ses membres, par leur action concertée, l'ont dotée des moyens tels que l'autonomie interne ET l'autonomie externe. Amenée ou non au clair de sa conscience, la pleine maîtrise de sa vie collective est ce à quoi aspire tout groupe organisé : il en pressent mieux qu'il n'en comprend la nécessité. Pareille maîtrise lui permet d'anticiper, bien avant qu'elle ne se concrétise, toute menace à sa vie collective et d'agir en conséquence. Qui ne dispose que d'une maîtrise partielle que d'une autonomie interne, par exemple est plus embarrassé.
Mais une collectivité peut aussi être réduite à végéter si une seconde la remplace et lui impose sa tutelle. On peut la comparer à une équipe sportive qu'une autre vient de déloger de l'unique terrain de jeu disponible. Dès lors qu'elle ne peut plus jouer, le nom d'équipe lui convient-il même quand ses équipiers sont repêchés par l'autre? S'approprier le champ de manœuvre d'une collectivité même si l'on en permet l'accès à certains de ses membres à titre individuel entraîne l'abolition de cette collectivité en tant que telle, ce qui constitue une oppression essentielle collective. Cette déchéance est la conséquence inévitable du remplacement imposé, une destitution que la bienveillance de l'oppresseur ni les déclarations incantatoires de l'opprimé ne peuvent conjurer.
Non plus que la vie collective n'est l'addition de vies individuelles, l'oppression collective n'est la somme d'oppressions individuelles. L'agir qu'elle entrave n'est pas celui des individus mais celui de la collectivité. Elle peut donc reconnaître à ceux-là ce qu'elle refuse à celle-ci en termes de droits et de liberté : l'oppression n'est alors que collective et tant qu'elle le demeure, on ne la remarque presque pas. Constatant des cas de « réussite » chez des membres de la société opprimée, on en viendrait même à nier l'existence de quelque oppression que ce soit puisque la seule espèce d'oppression qu'on puisse appréhender c'est-à-dire qu'on puisse saisir par l'imagination et craindre tout à la fois est celle qui accable les personnes. Ainsi perd-on de vue que ce qui pèse sur l'ensemble n'en affecte pas moins chacun puisque l'individu forme ses habitudes grâce au milieu dans lequel il vit : dynamique, il l'encadre; amorphe, il l'écrase.
L'oppression essentielle peut exister par elle-même sans occasionner de brutalités, de négligence ou d'incompréhension, qui seraient alors des oppressions accidentelles ou contingentes. Si elles devaient survenir cependant, on aurait tort de leur attribuer exclusivement tout ce que la tutelle comporte de nocif; tort de croire que, n'étaient ces abus, le remplacement en soi serait somme toute inoffensif.
Choisir l'oppression essentielle ou acquérir son autonomie interne et externe
Tout groupe qui se reconnaît distinct veut acquérir ou conserver, étendre ou défendre son autonomie dans tous les domaines à la fois : politique, économique et culturel. On donnera à cet exercice normal de la conscience collective le nom de « nationalisme » lorsqu'il est le fait d'une société et, à celle-ci, celui de « nation » lorsqu'elle jouit de l'autonomie interne et externe.
Cet exercice se dérègle chez une société en tutelle : sa pensée collective, dans son ensemble, est marquée au coin de l'inconséquence, de la désorientation. Son «nationalisme» n'en est bien souvent qu'une contrefaçon, en sorte que s'imaginer, en s'y opposant au nom de l'«universalisme», œuvrer à l'avènement de celui-ci est d'une insondable naïveté : on se fait l'agent inconscient du nationalisme de l'oppresseur.
C'est peut-être forcer le trait que de réserver aux seules sociétés intégralement autonomes le titre de « nations », mais comment pourrait-on autrement relever la démarcation capitale entre celles-ci et les autres collectivités moins heureuses et combien plus nombreuses! qui se retrouvent annexées ou, au pire, assimilées ?
« La lésion vitale que subit toute société remplacée lui rend incertaine une juste appréciation de la réalité. »
La lésion vitale que subit toute société remplacée lui rend incertaine une juste appréciation de la réalité. Davantage de lucidité lui en découvrirait bien la nature, mais sans la modifier pour autant. Du reste, cette réalité peut fort bien l'épouvanter... On comprend dès lors pourquoi cette société cherchera, en cultivant des illusions, à se dissimuler la réalité de sa déchéance. Illusions qui iront toutefois aggraver l'oppression inhérente au remplacement que subit déjà cette société.
«Si entretenir des illusions, taire des difficultés, escamoter des déficiences peuvent paraître faciliter l'action immédiate, à longue échéance la vérité même pénible se révélera plus profitable aux hommes d'action.» (Maurice Séguin)
Lorsqu'une société passe sous la domination d'une puissance étrangère, elle voit s'établir chez elle de nouveaux administrateurs et entrepreneurs qui remplacent ses anciens cadres politiques et économiques. Ces étrangers sont soutenus de l'extérieur par leur mère-patrie et cet avantage fait d'eux des majeurs, au sens juridique. Si d'autres de leurs congénères viennent les rejoindre, on assiste alors à la naissance d'une seconde société que la métropole nourrit et protège jusqu'à ce qu'elle évolue en puissance autonome ou qu'elle tombe à son tour sous la tutelle d'un autre peuple. Aussi peu nombreuse soit-elle, cette seconde société déclasse l'ancienne, majoritaire sans doute mais également mineure quant à sa capacité d'agir. Aux yeux des dirigeants métropolitains, seule la seconde peut se présenter comme le peuple officiel de leur province : au lieu d'en discerner deux, ils ne voient qu'un peuple...et demi. La demie, plus nombreuse pourtant, est la société remplacée réduite au rôle de spectatrice ou d'utilité et perçue comme intruse sur la terre de ses aïeux.
Le pseudo-nationalisme
« Aveuglée par son pseudo-nationalisme, l'opprimée escompte qu'il lui sera possible d'amener ces étrangers à aller à l'encontre de leur sûr instinct de possédants... »
S'adressant désormais à un État étranger, la société évincée s'attend néanmoins à ce qu'il encadre, assure et défende sa vie collective menacée par les progrès de sa concurrente. Or, c'est précisément celle-ci qu'il a pour mandat d'édifier, de consolider, de protéger dans la mesure où il entend conserver sa province : là réside sa raison d'être. L'État ne peut donc, en cas de litige, que conclure en faveur de la société formée de ses congénères quand la prépondérance de celle-ci est en cause. Cette préférence légitime est rarement avouée cependant car l'État voudrait qu'on l'estime impartial. À cet égard, l'opprimée passe ses attentes car si elle devait s'aviser de cette prédilection puis en rechercher les raisons, force lui serait d'admettre qu'aux yeux de cet État, elle n'est guère mieux qu'un demi-peuple qu'il tolère. Elle tentera plutôt de se convaincre que « la prochaine fois », en lui soumettant de meilleurs arguments et en s'assurant d'improbables appuis parmi les membres de l'autre société elle pourra enfin induire cet État étranger qu'elle refuse de considérer tel sous prétexte qu'elle lui verse ses impôts à enfin garantir son droit à l'autonomie, ce qui équivaudrait à lui subordonner sa concurrente. Aveuglée par son pseudo-nationalisme, l'opprimée escompte qu'il lui sera possible d'amener ces étrangers à aller à l'encontre de leur sûr instinct de possédants et d'en faire les exécutants dociles de leur propre déchéance...
On retrouve souvent, dans le nationalisme d'une collectivité opprimée, ce mélange inconscient de rouerie et de naïveté. Une autre de ses caractéristiques est l'inversion des rapports. Pour une société normale, disposer librement de soi lui importe davantage que conserver son particularisme en lequel elle reconnaît une manière d'agir, forcément consécutive au fait d'exister. On observe l'inverse chez une société remplacée : son pseudo-nationalisme la dissuade, par là même, de se doter de l'unique moyen à savoir l'autodétermination - qui lui garantirait sa manière d'agir langue, lois, religion, coutumes- et sans lequel celle-ci n'est plus qu'un simulacre inopérant. Ce pseudo-nationalisme lui persuade en somme qu'elle peut s'affirmer ouvertement... dans l'inexistence politique; qu'elle peut par exemple imposer sa langue aux étrangers vivant sur le même territoire qu'elle sans encourir le désaveu de l'État qui les protège. Cette manière d'agir, qui différencie l'opprimé de son oppresseur, suffirait, selon le pseudo-nationalisme, à l'en distinguer. En réalité, seule la société remplaçante qui jouit de l'autonomie intégrale est distincte des autres nations, y compris de celles dont elle partage la manière (langue, mœurs). En cas de guerre, elle peut décider de s'allier avec ses semblables, mais à ses conditions, comme elle peut choisir de s'abstenir, mais toujours suivant son intérêt. N'avoir rien de commun avec son remplaçant n'apporte rien de tel pour la remplacée, qui ne peut que lui emboîter le pas. Son pseudo-nationalisme qui s'ingénie à relever les similitudes culturelles du maître avec des nations apparentées afin de conclure à son «insignifiance»- est d'un bien mince réconfort. Il lui fait oublier que, faute d'existence politique, des collectivités durent envoyer leurs fils mourir à l'étranger.
(30)Inédit, 15.09.2004/14-10-2004
© Le Rond-Point des sciences humaines, Québec, 2004
(*) François Robichaud (Montréal, 1956). Au terme de ses études au Collège Stanislas et à l'Université Concordia (Beaux-Arts), s'inscrit en histoire à l'Université de Montréal. Correcteur-réviseur pour le Mémorial du Québec. En 1981, suit le cours de Maurice Séguin et, l'année suivante, ceux d'André Lefebvre en Didactique de l'histoire. Enseigne cette matière au secondaire. Un des fondateurs de la revue Indépendance (1986-1989). Travaille également à son compte comme traducteur-interprète.